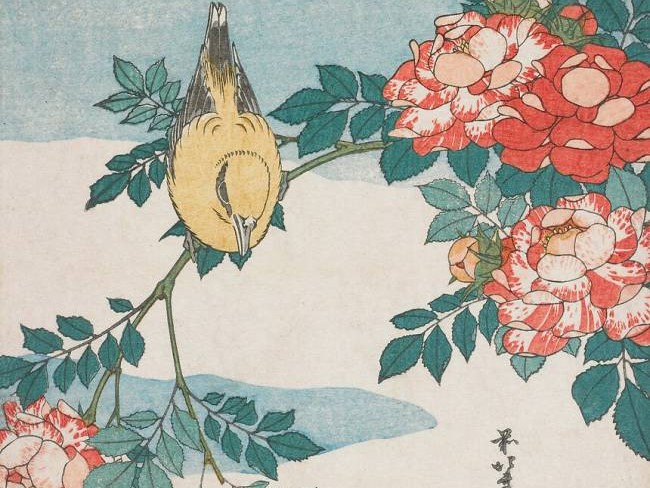Le calife
Autrefois dans Bagdad le calife Almamon
Fit bâtir un palais plus beau, plus magnifique,
Que ne le fut jamais celui de Salomon.
Cent colonnes d’albâtre en formaient le portique ;
L’or, le jaspe, l’azur, décoraient le parvis ;
Dans les appartements embellis de sculpture,
Sous des lambris de cèdre, on voyait réunis
Et les trésors du luxe et ceux de la nature,
Les fleurs, les diamants, les parfums, la verdure,
Les myrtes odorants, les chefs-d’œuvres de l’art,
Et les fontaines jaillissantes
Roulant leurs ondes bondissantes
A côté des lits de brocard.
Près de ce beau palais, juste devant l’entrée,
Une étroite chaumière, antique et délabrée,
D’un pauvre tisserand était l’humble réduit.
Là, content du petit produit
D’un grand travail, sans dette et sans soucis pénibles,
Le bon vieillard, libre, oublié,
Coulait des jours doux et paisibles,
Point envieux, point envié.
J’ai déjà dit que sa retraite
Masquait le devant du palais.
Le vizir veut d’abord, sans forme de procès,
Qu’on abatte la maisonnette ;
Mais le calife veut que d’abord on l’achète.
Il fallut obéir : on va chez l’ouvrier,
On lui porte de l’or. « Non, gardez votre somme,
Répond doucement le pauvre homme ;
Je n’ai besoin de rien avec mon atelier :
Et, quant à ma maison, je ne puis m’en défaire ;
C’est là que je suis né, c’est là qu’est mort mon père ;
Je prétends y mourir aussi.
Le calife, s’il veut, peut me chasser d’ici ;
Il peut détruire ma chaumière :
Mais, s’il le fait, il me verra
Venir, chaque matin, sur la dernière pierre
M’asseoir et pleurer ma misère :
Je connais Almamon, son cœur en gémira. »
Cet insolent discours excita la colère
Du vizir, qui voulait punir ce téméraire,
Et sur-le-champ raser sa chétive maison.
Mais le calife lui dit : « Non,
J’ordonne qu’à mes frais elle soit réparée ;
Ma gloire tient à sa durée :
Je veux que nos neveux, en la considérant,
Y trouvent de mon règne un monument auguste :
En voyant le palais, ils diront : Il fut grand ;
En voyant la chaumière, ils diront : Il fut juste. »
Les deux voyageurs
Le compère Thomas et son ami Lubin
Allaient à pied tous deux à la ville prochaine.
Thomas trouve sur son chemin
Une bourse de louis pleine ;
Il l’empoche aussitôt. Lubin, d’un air content,
Lui dit : « Pour nous la bonne aubaine !
— Non, répond Thomas froidement,
Pour nous n’est pas bien dit ; pour moi : c’est différent. »
Lubin ne souffle mot ; mais en quittant la plaine,
Ils trouvent des voleurs cachés au bois voisin.
Thomas tremblant, et non sans cause,
Dit : « Nous sommes perdus ! – Non, lui répond Lubin,
Nous n’est pas le vrai mot ; mais toi c’est autre chose. »
Cela dit, il s’échappe à travers le taillis.
Immobile de peur, Thomas est bientôt pris ;
Il tire la bourse et la donne.
Qui ne songe qu’à soi quand la fortune est bonne,
Dans le malheur n’a point d’amis.
Les deux jardiniers
Deux frères jardiniers avaient par héritage
Un jardin dont chacun cultivait la moitié ;
Liés d’une étroite amitié,
Ensemble ils faisaient leur ménage.
L’un d’eux, appelé Jean, bel esprit, beau parleur,
Se croyait un très grand docteur ;
Et Monsieur Jean passait sa vie
A lire l’almanach, à regarder le temps
Et la girouette et les vents.
Bientôt, donnant l’essor à son rare génie,
Il voulut découvrir comment d’un pois tout seul
Des milliers de pois peuvent sortir si vite ;
Pourquoi la graine du tilleul,
Qui produit un grand arbre, est pourtant plus petite
Que la fève qui meurt à deux pieds du terrain ;
Enfin par quel secret mystère
Cette fève qu’on sème au hasard sur la terre
Sait se retourner dans son sein,
Place en bas sa racine et pousse en haut sa tige.
Tandis qu’il rêve et qu’il s’afflige
De ne point pénétrer ces importants secrets,
Il n’arrose point son marais ;
Ses épinards et sa laitue
Sèchent sur pied ; le vent du nord lui tue
Ses figuiers qu’il ne couvre pas.
Point de fruits au marché, point d’argent dans la bourse ;
Et le pauvre docteur, avec ses almanachs,
N’a que son frère pour ressource.
Celui-ci, dès le grand matin,
Travaillait en chantant quelque joyeux refrain,
Bêchait, arrosait tout du pêcher à l’oseille.
Sur ce qu’il ignorait sans vouloir discourir,
Il semait bonnement pour pouvoir recueillir.
Aussi dans son terrain tout venait à merveille ;
Il avait des écus, des fruits et du plaisir.
Ce fut lui qui nourrit son frère ;
Et quand Monsieur Jean tout surpris
S’en vint lui demander comment il savait faire :
« Mon ami, lui dit-il, voici tout le mystère :
Je travaille, et tu réfléchis ;
Lequel rapporte davantage ?
Tu te tourmentes, je jouis ;
Qui de nous deux est le plus sage ? »
Le lierre et le thym
« Que je te plains, petite plante !
Disait un jour le lierre au thym :
Toujours ramper, c’est ton destin ;
Ta tige chétive et tremblante
Sort à peine de terre, et la mienne dans l’air,
Unie au chêne altier que chérit Jupiter,
S’élance avec lui dans la nue.
— Il est vrai, dit le thym, ta hauteur m’est connue ;
Je ne puis sur ce point disputer avec toi :
Mais je me soutiens par moi-même ;
Et, sans cet arbre, appui de ta faiblesse extrême,
Tu ramperais plus bas que moi. »
Traducteurs, éditeurs, faiseurs de commentaires,
Qui nous parlez toujours de grec ou de latin
Dans vos discours préliminaires,
Retenez ce que dit le thym.
La fable et la vérité
La vérité, toute nue,
Sortit un jour de son puits.
Ses attraits par le temps étaient un peu détruits ;
Jeune et vieux fuyaient à sa vue.
La pauvre vérité restait là morfondue,
Sans trouver un asile où pouvoir habiter.
A ses yeux vient se présenter
La fable, richement vêtue,
Portant plumes et diamants,
La plupart faux, mais très brillants.
« Eh ! Vous voilà ! Bon jour, dit-elle :
Que faites-vous ici seule sur un chemin ? »
La vérité répond : « vous le voyez, je gèle ;
Aux passants je demande en vain
De me donner une retraite,
Je leur fais peur à tous : hélas ! Je le vois bien,
Vieille femme n’obtient plus rien.
— Vous êtes pourtant ma cadette,
Dit la fable, et, sans vanité,
Partout je suis fort bien reçue :
Mais aussi, dame vérité,
Pourquoi vous montrer toute nue ?
Cela n’est pas adroit : tenez, arrangeons-nous ;
Qu’un même intérêt nous rassemble :
Venez sous mon manteau, nous marcherons ensemble.
Chez le sage, à cause de vous,
Je ne serai point rebutée ;
A cause de moi, chez les fous
Vous ne serez point maltraitée :
Servant, par ce moyen, chacun selon son goût,
Grâce à votre raison, et grâce à ma folie,
Vous verrez, ma sœur, que partout
Nous passerons de compagnie. »
Source : Jean-Pierre Claris de Florian - Fables (1792)