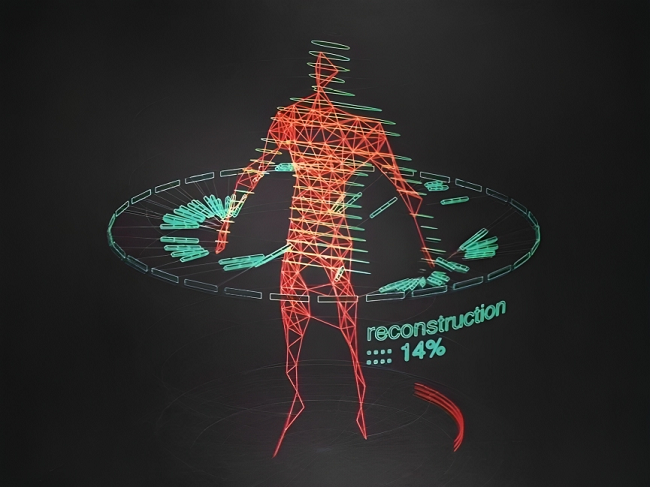Pour moi, je ne m’aperçois de la perte de mes richesses que par l’absence des embarras. Les appétits du corps sont bornés ; le corps veut seulement être garanti du froid, de la soif et de la faim ; au-delà tout désir est un vice, et non un besoin. Il n’est pas nécessaire de fouiller les plus profonds abîmes, de charger son ventre d’un immense carnage d’animaux, d’arracher les coquillages des bords inconnus de la mer la plus lointaine. Que les dieux et les déesses confondent ces insensés, dont le luxe a franchi les limites de ce vaste empire, objet de la jalousie universelle.
C’est de par delà le Phase qu’ils font venir les mets de leurs fastueuses orgies ; ils ne rougissent pas d’aller chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont nous ne sommes pas encore vengés. L’univers est mis à contribution par leur appétit blasé. Des extrémités de l’Océan on apporte des mets qui séjourneront à peine dans leur estomac affadi. Ils vomissent pour manger, ils mangent pour vomir ; et ces aliments, qu’ils ont cherchés par toute la terre, ils dédaignent de les digérer. Quel mal fait la pauvreté à qui méprise ces excès ? elle est même utile à qui les désire ; elle le guérit malgré lui ; et, dût-il rejeter les remèdes qu’il est forcé de prendre, l’impuissance, du moins, pendant ce temps, équivaut à la bonne volonté.
Caligula, que la nature semble n’avoir fait naître que pour montrer jusqu’où peuvent aller les vices les plus monstrueux avec une immense fortune, dévora dans un souper dix millions de sesterces ; et quoique soutenu par une cour fertile en expédients, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser en un repas le revenu de trois provinces.
Malheureux ceux dont le goût ne peut être réveillé que par des mets dispendieux ! Le prix de tels aliments ne provient ni de quelque saveur exquise, ni de la délicatesse du palais, mais de leur rareté et de la difficulté de se les procurer. Si l’homme voulait revenir à la raison, quel besoin aurait-il de tant d’artifices pour flatter sa gourmandise ? Pourquoi ces marchés ? pourquoi ces chasses et ces pêches, qui dévastent les forêts et dépeuplent l’océan ? Ne trouve-t-on pas partout des aliments ? la nature les a répandus en tous lieux. Mais on passe à côté sans les voir ; on parcourt les contrées, on traverse les mers ; et, quand on pourrait apaiser sa faim à peu de frais, on aime mieux l’irriter a force de dépenses.
« À quoi bon lancer des navires en mer ? » dirai-je à ces insensés. Pourquoi armer vos bras contre les bêtes sauvages, contre les hommes même ? pourquoi courir tumultueusement de tous côtés ? pourquoi entasser richesses sur richesses ? Ne songerez-vous jamais à la petitesse de vos corps ? N’est-ce pas le comble de l’égarement et de la folie, d’avoir, avec des moyens si bornés, des désirs immenses ? Augmentez vos revenus, reculez vos limites, jamais vous ne donnerez à vos corps plus d’étendue. Je veux que le commerce ait comblé vos désirs, que la guerre vous ait enrichis, que l’univers ait amoncelé sous vos yeux des provisions immenses ; vous n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pourquoi donc rechercher tant de choses ? Nos ancêtres, dont les vertus nous soutiennent encore aujourd’hui malgré nos vices, étaient sans doute bien malheureux de préparer leurs mets eux-mêmes, de coucher sur la dure, de n’avoir ni plafonds brillants d’or, ni temples étincelants du feu des pierreries. Mais la foi était respectée, quand on jurait par des dieux d’argile ; mais ceux qui les prenaient à témoin, revenaient chez l’ennemi pour y trouver la mort, plutôt que de manquer à leur serment.
Le dictateur qui écoutait les députés des Samnites, en retournant lui-même sur son foyer un grossier aliment, de cette même main qui plus d’une fois avait terrassé l’ennemi, et posé le laurier triomphal dans le sein du grand Jupiter, vivait-il donc moins heureux que, de notre temps, un Apicius qui, dans une ville d’où les philosophes avaient reçu l’ordre de sortir, comme corrupteurs de la jeunesse, donna des leçons de gloutonnerie, infecta son siècle de sa doctrine, et fit une fin qui mérite d’être rapportée ! Il avait prodigué pour sa cuisine un million de sesterces, absorbé en débauches une foule de présents dus à la munificence des princes, et englouti l’énorme subvention du Capitole : criblé de dettes, il fut forcé de vérifier ses comptes pour la première fois ; il calcula qu’il ne lui resterait plus que dix millions de sesterces ; et, ne voyant pas de différence entre mourir de faim et vivre avec une pareille somme, il s’empoisonna.
S’imaginer être pauvre avec dix millions de sesterces, quel luxe épouvantable ! Eh bien ! croyez après cela que le bonheur se mesure sur la richesse, et non sur l’état de l’âme ! Il s’est donc rencontré un homme qui a eu peur de dix millions de sesterces, un homme qui a fui, par le poison, ce que les autres convoitent avec tant d’ardeur. Certes, ce breuvage mortel fut le plus salutaire qu’eût jamais pris un être aussi dégradé. Il mangeait déjà et buvait du poison, lorsque non seulement il se plaisait à ces énormes festins, mais encore s’en glorifiait ; lorsqu’il faisait parade de ses désordres ; lorsqu’il fixait les regards de toute la ville sur ses débauches ; lorsqu’il excitait à l’imiter une jeunesse naturellement portée au vice, même sans y être entraînée par de mauvais exemples.
Tel est le sort des humains, quand ils ne règlent pas l’usage de leurs richesses sur la raison qui a ses bornes fixes, mais sur un appétit pervers dont les caprices sont immodérés et insatiables. Rien ne suffit à la cupidité, peu de chose suffit à la nature. La pauvreté dans l’exil n’est donc pas un mal : en effet, quel lieu si stérile qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance d’un banni ?
« Mais, dira-t-on, un exilé a besoin d’un vêtement et d’un domicile ». S’il ne lui faut absolument que ce qu’exige la nature, je réponds de sa demeure et de son vêtement ; il en coûte aussi peu pour couvrir l’homme que pour le nourrir ; en l’assujettissant au besoin, la nature lui a donné les moyens d’y satisfaire sans peine. S’il désire une étoffe saturée de pourpre, chamarrée d’or, nuancée de couleurs, enrichie de broderies, ce n’est plus la fortune, c’est lui-même qu’il doit accuser de son indigence. Que gagnerez-vous à lui rendre ce qu’il a perdu ? Rentré dans ses foyers, il trouvera dans ses désirs plus de sujets de privations qu’il n’en a essuyé pendant son exil.
S’il convoite un buffet étincelant de vases d’or ; une argenterie marquée au coin des plus célèbres artistes de l’antiquité ; cet airain, dont la manie de quelques riches, a fait tout le prix ; un peuple d’esclaves, capable de diminuer l’espace du plus vaste palais ; des bêtes de somme chargées d’un embonpoint factice et des pierres de toutes les contrées du monde ; vous aurez beau entasser tous ces objets de luxe, jamais ils ne rassasieront son âme insatiable. C’est ainsi qu’aucune boisson ne peut désaltérer celui dont la soif ne vient pas du besoin, mais de l’ardeur qui dévore ses entrailles : car ce n’est plus une soif, c’est une vraie maladie.
Cet excès n’est pas particulier à la gourmandise et à la cupidité. Telle est encore la nature des désirs qu’engendre le vice et non l’indigence : tous les aliments que vous leur prodiguez, loin de les satisfaire, ne font qu’accroître leur intensité. Ainsi, tant qu’on respecte les bornes de la nature, on ignore le besoin ; dès qu’on en sort, on rencontre la pauvreté, même au sein de l’opulence. Oui, tout, jusqu’à l’exil, nous fournit le nécessaire ; et des royaumes entiers ne pourraient suffire au superflu.
C’est l’âme qui fait la richesse ; elle suit l’homme en exil ; et, dans les plus affreux déserts, tant qu’elle trouve de quoi soutenir le corps, elle jouit de ses propres biens, et nage dans l’abondance. La richesse est aussi indifférente pour l’âme, que le sont pour les dieux tous les objets admirés des hommes ignorants et esclaves de leur corps. Ces pierres, cet or, cet argent, ces grandes tables circulaires d’un poli si parfait sont un poids matériel et terrestre, auquel ne peut s’attacher une âme incorruptible, toujours occupée de son origine, légère, exempte de tout soin, et prête à s’envoler au ciel dès qu’elle verra tomber ses chaînes. En attendant, malgré le poids des membres et l’épaisseur de la matière qui l’enveloppe, elle parcourt, sur les ailes rapides de la pensée, le séjour des immortels.
Ainsi, dans sa liberté, participant à la nature des dieux, embrassant le temps et le monde, elle ne peut être bannie. La pensée s’élance dans toute l’étendue des cieux, dans les temps passés, dans les temps à venir. Ce faible corps, prison et lien de l’âme, est agité dans tous les sens ; c’est sur lui que s’exercent et les supplices, et les brigandages, et les maladies ; mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle, et nul bras ne saurait l’atteindre.
Source : Sénèque - Consolation à ma mère Helvia