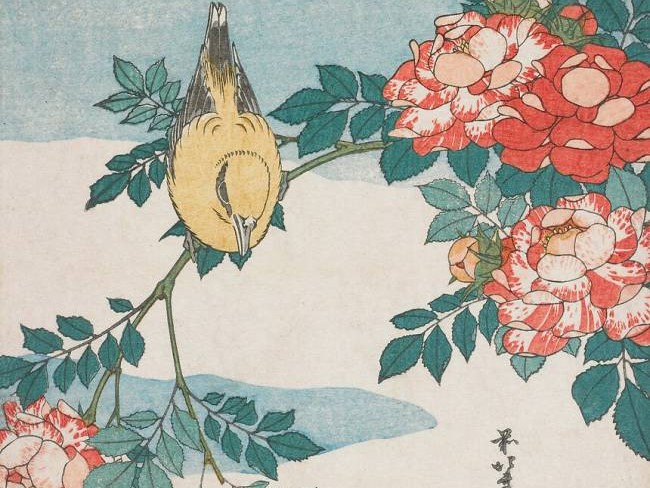Les exécutions étaient, à cette époque, devenues assez peu fréquentes pour que mon père ne conservât que quatre aides. En raison du nombre des condamnés, il fut obligé de requérir des aides supplémentaires. On avait déjà repris l’habitude de permettre aux condamnés de se faire accompagner par un prêtre jusque sur le lieu du supplice ; en conséquence, le nombre des charrettes qui devaient transporter ce cortège funèbre fut élevé à trois. A neuf heures du matin, les voitures et les exécuteurs étaient à la porte de la Conciergerie. Les apprêts de la toilette se firent dans l’avant-greffe ; les condamnés y furent introduits tous ensembles ; ils priaient avec beaucoup de recueillement. Quelques instants auparavant, on avait, une fois encore, engagé Cadoudal à demander sa grâce : il avait montré plus de vivacité encore dans ses refus, et on l’avait entendu murmurer en sortant du greffe : « Ce b…..-là ! il n’est pas content de me couper la tête, il voudrait encore me déshonorer ! »
En entrant dans la salle, Georges dit quelques mots à un guichetier nommé Eberle, qui l’accompagnait, et, après la réponse de celui-ci, il alla droit à mon père. Sa démarche était fière, son œil assuré, son teint aussi coloré que d’ordinaire, nulle émotion ne se manifestait ni dans ses traits, ni dans son accent.
« Monsieur, dit-il, vous êtes l’exécuteur de paris ? »
Mon père répondit affirmativement.
« En ce cas, répliqua Georges, vous saurez que je veux être exécuté le premier. C’est à moi à donner à mes camarades l’exemple du courage et de la résignation ; d’ailleurs, je ne veux pas que l’un d’eux s’en aille de ce monde avec l’idée que je pourrais lui survivre. »
Mon père lui fit observer que l’ordre d’exécution avait été réglé, et que, suivant cet ordre, il devait mourir le dernier.
« Bah ! » répliqua Georges, « on a mis assez d’insistance à m’offrir une grâce entière pour qu’il ne soit pas possible de me refuser la seule que je sollicite. »
Dans l’espoir de pouvoir obtempérer à ce désir, mon père profita de la longueur des apprêts occasionnés par un si grand nombre de condamnés, pour faire transmettre la demande de Georges au grand juge par le greffe qui était venu lire l’arrêt et devait dresser le procès-verbal de l’exécution. Ce dernier ne rapporta qu’un refus ; on ne permit pas à celui à qui on avait offert la vie de choisir le moment de sa mort.
Le rude chef de partisans dut se résigner. Pendant qu’on lui attachait les mains, il dit à ses compagnons :
« Nous avions assez souvent battu les bleus pour avoir droit à la mort de soldats ; mais nous ne devons rien regretter, en nous rappelant que l’échafaud sur lequel nous allons monter a été consacré par le martyre de notre roi ! »
Avant de quitter la Conciergerie, il dit encore à ses camarades de l’embrasser. Tous obéirent ; ces rudes visages s’adoucirent dans ce suprême adieu à leur chef bien-aimé ; quelques yeux devinrent humides. Quand ce fut terminé, il leur dit : « Et maintenant, il s’agit de montrer aux Parisiens comment meurent des chrétiens, des royalistes et des Bretons. »
Il fit signe à son confesseur de lui donner le bras, et, sans attendre l’ordre de l’exécuteur, il commanda : « Marche ! » avec autant de vivacité et d’élan que s’il se fut agi d’enlever une redoute.Il était dans la première charrette avec son cousin, Pierre Cadoudal ; Picot, son domestique, et Coster Saint-Victor ; Roger, Soyant, Burban et Lemercier étaient dans la seconde ; Lelan, Mérille et Deville étaient dans la troisième. Coster Saint-Victor n’excitait pas moins de curiosité que son chef. Sa beauté ; sa haute mine, son élégance, les bonnes fortunes qu’on lui attribuait, en avaient fait le lion du procès. Le public avait fini par se passionner pour le conspirateur, et, sur le passage du cortège, on entendit à plusieurs reprises des paroles de compassion s’élever de la foule. Pendant le trajet, Georges, devenu sombre et taciturne depuis qu’on lui avait refusé la faveur qu’il avait sollicités, n’avait cessé de répéter ses prières. Il vit descendre sans mot dire tous ses compagnons, même Coster Saint-Victor, qui, étant le dernier à le précéder sur l’échafaud, voulut l’embrasser encore, et lui dit, dans ce baiser suprême :
« Adieu, mon général ! »
Georges, en se laissant faire, haussa les épaules comme devant un acte de faiblesse ou de puérilité. Puis, quand la belle tête de son jeune complice fut tombée, il monta d’un pas très lent, mais très ferme, les marches de l’échafaud, et lorsqu’il fut arrivé sur la plate-forme, il s’écria d’une voie retentissante :
« Camarades, je vous rejoins ! Vive le roi ! »
Après cette dernière victime, il y eu un moment de confusion. En présence de cette exécution multiple, les précautions avaient été mal prises. Lorsque la tête de Cadoudal tomba, les paniers apportés étaient pleins. Le cadavre colossal de l’assassin-chevalier, qui devait faire souche de gentilshommes, resta plus d’un quart d’heure sur l’échafaud, jusqu’à ce que mon père eut le temps d’envoyer acheter de la toile pour lui faire un linceul à part. Cette dernière marque de respect n’était peut-être point usurpée par l’homme qui a occupé une place si exceptionnelle entre les conventionnels régicides et les pâles assassins du Consulat, de la Restauration, de la monarchie de Juillet et du Second Empire.
Source : Henry-Clément Sanson - Mémoires des Sanson, Sept générations d’exécuteurs