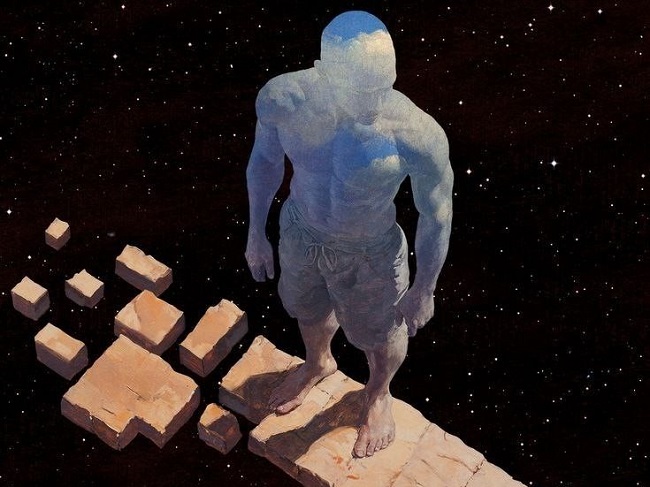Ce qu’il faudrait pouvoir expliquer, c’est l’intérêt marqué des artistes paléolithiques pour l’obscurité des grottes. Certes, leur talent s’est également exprimé en plein air, mais c’est un lieu commun de dire qu’il fallait une motivation bien particulière, et certainement très puissante, pour aller peindre au fond de sombres cavernes, aidé seulement de faibles lampes à graisse, en risquant glissades et chutes sur le sol humide, en évitant puits et gouffres, en franchissant chatières et boyaux ouvrant sur l’inconnu, bref : en surmontant sa peur. Pour s’en convaincre, il suffit de lire cette description de la grotte de la Sotarriza, publiée en 1921 par Thomas Mainage :
À la Sotarriza, la grotte forme un long boyau à peu près rectiligne. Le plafond demeure sensiblement horizontal. Mais le sol fuit littéralement sous les pieds, par un talus de pierrailles mobiles à pente voisine de 45 degrés, qui vous mène à trente mètres plus bas sur une pente moins oblique mais extrêmement glissante de convexités argilostalagmatiques. Bientôt le sol devient un peu plus aplani, mais on est arrêté par une fondrière de 1,70 mètre de profondeur sur trois mètres de long. Les parois sont à pic. On ne peut facilement les franchir sans aide. Au-delà, la voie est libre, mais le plancher reste glissant. Or jusqu’au dernier mètre de cet étrange souterrain, pas une figure n’est apparue. Seulement, lorsqu’on est sur le point de buter contre la paroi terminale, tout à coup, sur la gauche, à la hauteur des yeux, un petit cheval se détache en tracé linéaire. Ainsi, pour venir le peindre, l’artiste a dû dévaler la pente instable des cailloux, se tenir en équilibre sur le plancher glissant des stalagmites, franchir la fondrière. Et comme s’il n’eut pas été rassuré d’avoir amoncelé derrière lui tant d’obstacles, il est allé, aussi loin que possible, inscrire sur un pan de rocher ce modeste dessin que nous retrouvons intact après des milliers d’années. Qu’est-ce donc que l’art décoratif peut avoir de commun avec cet appétit de clandestinité ? Ou plutôt à quelle manipulation secrète l’homme est-il venu se livrer au fond de ce terrier inhabitable ?
Les images pariétales ainsi exécutées en des lieux particulièrement éloignés et difficiles d’accès ne manquent pas. À Cosquer, pour apposer sa marque sur le « panneau des Mains », il fallait se pencher au-dessus du vide pour vaporiser le colorant. À Nerja, des peintures très en hauteur ont nécessité d’accomplir une escalade fort périlleuse. Pour réaliser certaines œuvres, il a fallu franchir des passages très étroits, comme à la Clotilde de Santa Isabel, à Marsoulas ou à Niaux, ou même des pertuis inquiétants, comme le « rubicon » de Font-de-Gaume, qui ne mesure qu’une quarantaine de centimètres de large ! La Pasiega a inspiré cette remarque à Émile Cartailhac et l’abbé Breuil : « Nulle part peut-être, plus que dans le labyrinthe de la Pasiega, aux galeries parfois périlleuses, s’ouvrant par d’étroits pertuis au sommet d’une côte inaccessible, nous n’avons eu le sentiment du mystère voulu et recherché, dans un arcane interdit aux profanes ».
Pour reprendre les termes d’Alain Roussot, on peut affirmer sans crainte qu’« il est difficile de prétendre que les Paléolithiques ont pénétré si loin sous terre pour le seul plaisir d’y graver ou d’y peindre des animaux et d’étranges signes, parfois dans des recoins peu faciles d’accès, voire dangereux ». Renaud Ego songe que les artistes auraient répondu à l’appel de créatures cachées, « et il fallait bien que cet appel fût d’une urgence absolue pour que, en quête d’une réponse ou d’un contact, ils se soient enfoncés dans ces orifices qui étaient parfois des boyaux si étroits et tortueux ».
S’agissant de tels recoins, il est également remarquable que bien des images se trouvent dans des culs-de-sac, comme à la Cova Negra, ou dans des réduits surbaissés où il faut se courber, s’accroupir ou s’allonger pour les voir (Niaux, Altamira, La Pileta, La Pasiega, Hornos de la Peña, Castillo, El Pendo…). Se faisant les porte-parole de la majorité de leurs collègues, Anne-Catherine Welté et Georges-Noël Lambert ont dit percevoir « à travers les grandes fresques animalières (la Rotonde et l’Abside de Lascaux, ou la Nef de cette grotte, la “chapelle des Mammouths” et le Combel de Pech-Merle, le “Grand Plafond” de Rouffignac, le Salon noir de Niaux, le Sanctuaire des Trois-Frères) une sorte de magnification de la création animale et, forcément, de sa vitalité réelle ou mythique ».
On a pu soutenir que certaines des peintures de Lascaux ont été « conçues pour être vues », car elles comportent au moins deux cas d’anamorphoses sur des images de grands bovinés qui présentent des proportions incorrectes quand on les contemple dans la position de l’artiste qui les réalisa, mais qui, observées d’en bas, paraissent tout à fait réalistes. Norbert Aujoulat et Romain Pigeaud ont considéré que ces déformations étaient volontaires, ce qui constitue une supposition parfaitement raisonnable, mais non démontrée. En effet, que ces déformations existent est indéniable, mais qu’elles résultent d’un projet concerté n’est pas certain, puisque dans la même grotte, il en existe d’autres qui ne peuvent s’expliquer de la même façon. Par exemple, sur la même paroi et à la même hauteur que le grand taureau aux pattes supposément déformées de façon volontaire, les membres antérieurs trop courts de la « licorne » ne peuvent se justifier, non plus que les disproportions entre les pattes des cerfs.
Contrairement à ces figures qui auraient été exécutées pour être vues (?), il n’est pas rare que des images aient été réalisées en des lieux nécessitant, pour les atteindre, une reptation en d’étroits boyaux ou le long de passages difficiles, comme à Mayenne-Sciences, Bédeilhac, aux Trois-Frères, ou bien qu’elles aient été placées « dans un endroit inattendu, dans un diverticule presque impénétrable, dans un coin caché… ». Le caractère somptueux des grandes surfaces peintes et très médiatisées, comme celle de la « Rotonde » de Lascaux, ne doit pas nous faire oublier que de nombreuses figures animalières sont situées en des lieux discrets, comme dans le boyau terminal de Cougnac ou à l’extrémité du Combel. Brigitte et Gilles Delluc ont mentionné plusieurs cas de décors non destinés à être vus, par exemple dans la « galerie des Femmes » de la grotte de Fronsac, où les gravures « ont été réalisées sur les parois rocheuses d’un étroit conduit aux parois tortueuses large seulement de 40 centimètres, sans possibilité de prendre du recul ». De même, pour réaliser les gravures de la grotte de la Font-Bargeix, il a fallu « ramper dans une étroite fente rocheuse haute de 50 centimètres, s’abaissant jusqu’à 30 centimètres », et pourtant les parois et la voûte de cet espace réduit ont été ornées de gravures « jusqu’à l’extrême fond pénétrable ». Lorsque le Grand Plafond de Rouffignac fut orné, il n’était accessible qu’en rampant, et les artistes qui s’y exprimèrent n’ont jamais vu leurs œuvres en entier. Quant au grand cheval de Commarque, gravé dans une galerie de quatre-vingts centimètres de large et après un étranglement, il est impossible de le voir en entier d’un seul coup d’œil, et il faut se déplacer pour le voir d’un bout à l’autre.
Du fait de l’exiguïté de leur situation, certaines œuvres ne sont donc parfois visibles que par un tout petit nombre de personnes, voire une seule ou même… aucune ! C’est ainsi que, dans une diaclase de la grotte du Pergouset n’excédant pas vingt centimètres de largeur, quelqu’un a dessiné, bras tendu et à l’aveugle, un protomé de cheval très bien rendu, dans un endroit où l’on ne pouvait pas passer la tête pour le contempler. Cela signifie d’une part que l’artiste qui l’a réalisé savait dessiner des chevaux sans contrôle visuel, ce qui suppose un très sérieux apprentissage, et d’autre part que cette image ne fut en aucun cas dessinée pour être vue. Il pourrait en être de même pour bon nombre de figures qui ne consistent qu’en un aménagement minimal de formes naturelles, elles le remarque Clément Birouste : parfois tout juste perceptibles, elles ne semblent pas avoir été conçues pour être observées par d’autres que l’artiste lui-même.
Charles Stépanoff aboutit aux mêmes conclusions :
Des centaines de figures gravées dans les grottes sont superposées au point d’être parfaitement indémêlables pour tout autre qu’un archéologue, ainsi dans l’abside de Lascaux ou sur les parois de la grotte des Trois-Frères. Si ces images étaient destinées à la seule perception visuelle humaine, pourquoi les avoir si maladroitement rendues illisibles ? Ou faut-il supposer que c’est aux archéologues que les Paléolithiques voulaient en réserver la jouissance ?
Que l’art des cavernes ait été généralement réalisé pour être contemplé relève donc d’une fausse évidence, puisque ce cheval de Pergouset n’a jamais été contemplé, pas même par l’artiste qui l’a conçu, avant que les procédés modernes de relevés permettent enfin de le visualiser. On ne saurait mieux illustrer le thème de l’« œuvre d’art sans spectateur » qu’évoquait Paul Veyne en réponse à l’idée, devenue lieu commun depuis son élaboration par Émile Mâle, de la cathédrale comme « livre de pierre » et « Bible des pauvres ». Paul Veyne rappelle qu’il est impossible de voir le détail du décor de la colonne trajane et que, au sommet de la falaise de Behistun en l’actuel Iran, le roi Darius fit graver une inscription trilingue (en vieux perse, élamite et akkadien) qui « n’était pas faite pour être lue : elle est placée au sommet d’un à-pic et seuls les aigles ou des alpinistes suspendus à leur corde auraient pu la lire ». Dans mainte église ou cathédrale, certains chapiteaux historiés sont situés à une telle hauteur qu’il faut une bonne paire de jumelles pour identifier les motifs bibliques qu’ils illustrent. Et, bien sûr, de nombreux tombeaux antiques (égyptiens, grecs, étrusques, chinois…) sont ornés de fresques, bien que parfaitement clos. L’affirmation selon laquelle certaines images ne furent aucunement réalisées pour être vues ne devrait donc pas surprendre.
Il nous faut donc non seulement expliquer cet intérêt des artistes pour le monde chthonien, mais aussi trouver pourquoi leurs explorations souterraines les conduisirent à réaliser des images sur les parois des grottes, pourquoi ces images représentent essentiellement des animaux, secondairement des femmes ou des sexes féminins, comme aussi quelques êtres hybrides de toute homme-animal, et pourquoi ces images semblent « flotter » loin de toute intention de représenter la réalité : dans l’ensemble de l’art paléolithique, la ligne de sol n’a été représentée de façon certaine que trois fois dans l’art mobilier, et elle n’est guère plus fréquente dans l’art pariétal. De plus, les groupements sont volontiers irréalistes, voire fabuleux, et les images n’avaient pas forcément pour finalité d’être vues. Une chose reste certaine : les artistes n’ont pas cherché à représenter la réalité faunistique — qu’ils connaissaient parfaitement puisqu’ils étaient chasseurs. Croire le contraire serait céder à la « malédiction mimétique » qui, selon Mats Rosengren, a frappé tant d’études sur l’art des cavernes. Alors, qu’ont-ils voulu évoquer ou invoquer de si important, qui nécessitât de s’enfoncer dans la dangereuse nuit des cavernes ? De nombreuses hypothèses ont été formulées pour répondre à cette question, et si toutes ne sont pas à rejeter, aucune n’emporte entièrement la conviction.
Source : Jean-Loïc Le Quellec - La caverne originelle