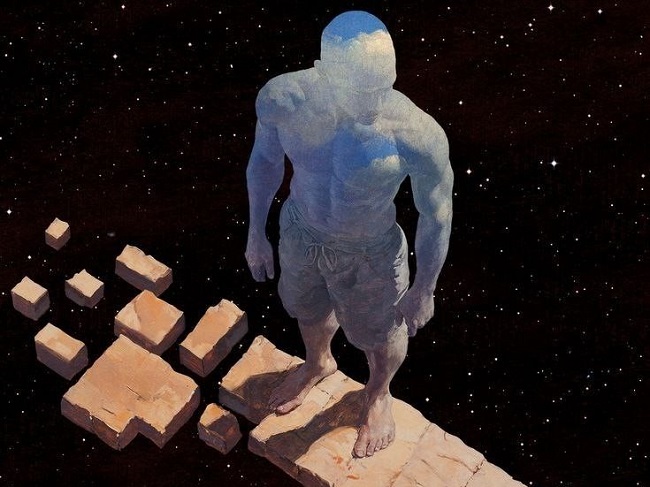Les gens d’une espèce plus noble et doués de facultés plus élevées trahissent, principalement dans leur jeunesse, un manque surprenant de connaissance des hommes et de savoir-faire ; ils se laissent ainsi facilement tromper ou égarer ; tandis que les natures inférieures savent bien mieux et bien plus vite se tirer d’affaire dans le monde ; cela vient de ce que, à défaut d’expérience, l’on doit juger a priori et qu’en général aucune expérience ne vaut l’a priori. Chez les gens de calibre ordinaire, cet a priori leur est fourni par leur propre moi, tandis qu’il ne l’est pas à ceux de nature noble et distinguée, car c’est par là précisément que ceux-ci diffèrent des autres. En évaluant donc les pensées et les actes des hommes ordinaires d’après les leurs propres, le calcul se trouve être faux.
Mais même alors qu’un tel homme aura appris enfin a posteriori, c’est-à-dire par les leçons d’autrui et par sa propre expérience, ce qu’il y a à attendre des hommes ; même alors qu’il aura compris que les cinq sixièmes d’entre eux sont ainsi faits, au moral comme à l’intellectuel, que celui qui n’est pas forcé par les circonstances d’être en relation avec eux fait mieux de les éviter dès l’abord et de se tenir autant que possible hors de leur contact, même alors cet homme ne pourra, malgré tout, avoir une connaissance suffisante de leur petitesse et de leur mesquinerie ; il aura durant toute sa vie à étendre et à compléter cette notion ; mais jusqu’alors il fera encore bien des faux calculs à son détriment. En outre, bien que pénétré des enseignements reçus, il lui arrivera encore parfois, se trouvant dans une société de gens qu’il ne connaît pas encore, d’être émerveillé en les voyant tous paraître, dans leurs discours et dans leurs manières, entièrement raisonnables, loyaux, sincères, honnêtes et vertueux, et peut-être bien aussi intelligents et spirituels. Mais que cela ne l’égare pas ; cela provient tout simplement de ce que la nature ne fait pas comme les méchants poètes, qui, lorsqu’ils ont à présenter un coquin ou un fou, s’y prennent si lourdement et avec une intention si accentuée que l’on voit paraître pour ainsi dire derrière chacun de ces personnages l’auteur désavouant constamment leur caractère et leurs discours et disant à haute voix et en manière d’avertissement : « Celui-ci est un coquin, cet autre un fou ; n’ajoutez pas foi à ce qu’il dit. » La nature au contraire s’y prend à la façon de Shakespeare et de Gœthe : dans leurs ouvrages, chaque personnage, fût-il le diable lui-même, tant qu’il est en scène, parle comme il a raison de parler ; il est conçu d’une manière si objectivement réelle qu’il nous attire et nous force à prendre part à ses intérêts ; pareil aux créations de la nature, il est le développement d’un principe intérieur en vertu duquel ses discours et ses actes apparaissent comme naturels et par conséquent comme nécessaires. Celui qui croit que dans le monde les diables ne vont jamais sans cornes et les fous sans grelots sera toujours leur proie ou leur jouet. Ajoutons encore à tout cela que, dans leurs relations, les gens font comme la lune et les bossus, c’est-à-dire qu’ils ne nous montrent jamais qu’une face ; ils ont même un talent inné pour transformer leur visage, par une mimique habile, en un masque représentent très exactement ce qu’ils devraient être en réalité ; ce masque, découpé exclusivement à la mesure de leur individualité, s’adapte et s’ajuste si bien que l’illusion est complète. Chacun se l’applique toutes les fois qu’il s’agit de se faire bien venir. Il ne faut pas plus s’y lier qu’a un masque de toile cirée, et rappelons-nous cet excellent proverbe italien : « Non è si tristo cane, che non meni la coda » (Il n’est si méchant chien qui ne remue la queue).
Gardons-nous bien, en tout cas, de nous faire une opinion très favorable d’un homme dont nous venons de faire la connaissance ; nous serions ordinairement déçus à notre confusion, peut-être même à notre détriment. Encore une observation digne d’être notée : c’est précisément dans les petites choses, où il ne songe pas à soigner sa contenance, que l’homme dévoile son caractère ; c’est dans des actions insignifiantes, quelquefois dans de simples manières, que l’on peut facilement observer cet égoïsme illimité, sans égard pour personne, qui ne se démentira pas non plus ensuite dans les grandes choses, mais qui se dissimulera. Que de semblables occasions ne soient pas perdues pour nous ! Quand un individu se conduit sans aucune discrétion dans les petits incidents journaliers, dans les petites affaires de la vie, auxquelles s’applique le : « De minimis lex non curat » (La loi ne s’occupe pas des affaires minimes), quand il ne recherche dans ces occasions que son intérêt ou ses aises au détriment d’autrui, ou s’approprie ce qui est là pour servir à tous, etc., cet individu, soyez-en bien convaincu, n’a pas dans le cœur le sentiment du juste ; il sera un gredin tout aussi bien dans les grandes circonstances, toutes les fois que la loi ou la force ne lui lieront pas les bras ; ne permettez pas à cet homme de franchir votre seuil. Oui, je l’affirme, qui viole sans scrupule les règlements de son club violera également les lois de l’État dès qu’il pourra le faire sans danger.
Quand un homme avec qui nous sommes en rapports plus ou moins étroits nous fait quelque chose qui nous déplaît ou nous fâche, nous n’avons qu’à nous demander s’il a ou non assez de prix à nos yeux pour que nous acceptions de sa part, une seconde fois et à reprises toujours plus fréquentes, un traitement semblable, voire même un peu plus accentué (pardonner et oublier signifient jeter par la fenêtre des expériences chèrement acquises). Dans le cas affirmatif, tout est dit ; car parler simplement ne servirait de rien : il faut alors laisser passer la chose, avec ou sans admonition ; mais nous devrons nous rappeler que, de cette façon, nous nous en attirons bénévolement la répétition. Dans la seconde alternative, il nous faut, sur-le-champ et à jamais, rompre avec le cher ami, ou, si c’est un serviteur, le congédier. Car il fera, le cas échéant, inévitablement et exactement la même chose, ou quelque chose d’entièrement analogue, quand même en ce moment il nous jurerait le contraire, bien haut et bien sincèrement. On peut tout oublier, tout, excepté soi-même, excepté son propre être. En effet, le caractère est absolument incorrigible, parce que toutes les actions humaines partent d’un principe intime, en vertu duquel un homme doit toujours agir de même dans les mêmes circonstances et ne peut pas agir autrement. Lisez mon mémoire couronné sur la prétendue liberté de la volonté et chassez toute illusion. Se réconcilier avec un ami avec lequel on avait rompu est donc une faiblesse que l’on aura à expier alors que celui-ci, à la première occasion recommencera à faire exactement ce qui avait amené la rupture, et même avec un peu plus d’assurance, car il a la secrète conscience de nous être indispensable. Ceci s’applique également aux domestiques congédiés que l’on reprend à son service. Nous devons tout aussi peu, et pour les mêmes motifs, nous attendre à voir un homme se comporter de la même manière qu’une fois précédente, quand les circonstances ont changé. Au contraire, la disposition et la conduite des hommes changent tout aussi vite que leur intérêt : les intentions qui les meuvent émettent leurs lettres de change à si courte vue, qu’il faudrait avoir soi-même la vue plus courte encore pour ne pas les laisser protester.
Supposons maintenant que nous voulions savoir comment agira une personne dans une situation où nous avons l’intention de la placer ; pour cela, il ne faudra pas compter sur ses promesses et ses protestations. Car, en admettant même qu’elle parle sincèrement, elle n’en parle pas moins d’une chose qu’elle ignore. C’est donc par l’appréciation des circonstances dans lesquelles elle va se trouver, et de leur conflit avec son caractère, que nous aurons à nous rendre compte de son attitude.
En thèse générale, pour acquérir la compréhension nette, approfondie et si nécessaire de la véritable et triste condition des hommes, il est éminemment instructif d’employer, comme commentaire à leurs menées et à leur conduite sur le terrain de la vie pratique, leurs menées et leur conduite dans le domaine littéraire, et vice versa. Cela est très utile pour ne se tromper ni sur soi ni sur eux. Mais, dans le cours de cette étude, aucun trait de grande infamie ou sottise, que nous rencontrions soit dans la vie soit en littérature, ne devra nous devenir matière à nous attrister ou irriter ; il devra servir uniquement à nous instruire comme nous offrant un trait complémentaire du caractère de l’espèce humaine, qu’il sera bon de ne pas oublier. De cette façon, nous envisagerons la chose comme le minéralogiste considère un spécimen bien caractérisé d’un minéral, qui lui serait tombé entre les mains. Il y a des exceptions, il y en a même d’incompréhensiblement grandes, et les différences entre les individualités sont immenses ; mais, pris en bloc, on l’a dit dès longtemps, le monde est mauvais ; les sauvages s’entre-dévorent et les civilisés s’entre-trompent, et voilà ce qu’on appelle le cours du monde. Les États, avec leurs ingénieux mécanismes dirigés contre le dehors et le dedans et avec leurs voies de contrainte, que sont-ils donc, sinon des mesures établies pour mettre des bornes à l’iniquité illimitée des hommes ? Ne voyons-nous pas, dans l’histoire entière, chaque roi, dès qu’il est solidement assis et que son pays jouit de quelque prospérité, en profiter pour tomber avec son armée, comme avec une bande de brigands, sur les États voisins ? Toutes les guerres ne sont-elles pas, au fond, des actes de brigandage ? Dans l’antiquité reculée comme aussi pendant une partie du moyen âge, les vaincus devenaient les esclaves des vainqueurs, ce qui, au fond, revient à dire qu’ils devaient travailler pour ceux-ci ; mais ceux qui payent des contributions de guerre doivent en faire autant, c’est-à-dire qu’ils livrent le produit de leur travail antérieur. Dans toutes les guerres, il ne s’agit que de voler, a écrit Voltaire ; et que les Allemands se le tiennent pour dit.
Source : Arthur Schopenhauer - Pensées, maximes et aphorismes, 29