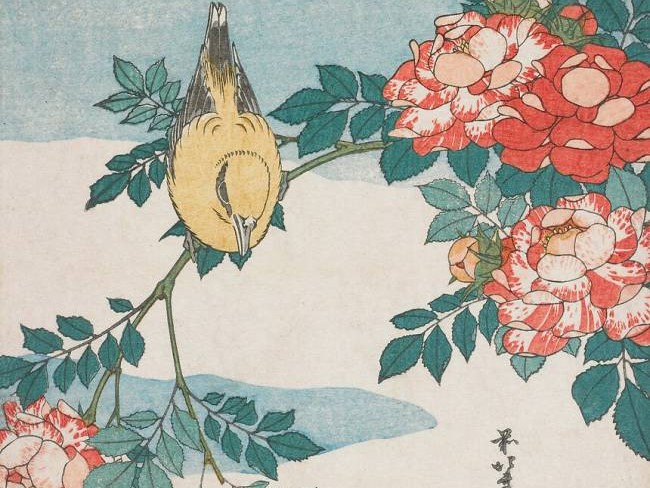À tous ceux qu’un fléau public doit abattre, la Fortune donne le temps d’appréhender ses coups : toute grande catastrophe laisse un répit quelconque avant de se consommer : ici il n’y eut que l’espace d’une nuit entre une puissante ville et plus rien ; que dis-je ? elle a péri en moins de temps que je ne le raconte. Tout cela brise le cœur patriotique de notre Libéralis, pour lui-même si ferme et si résolu. Ce n’est pas à tort qu’il est bouleversé : l’inattendu accable davantage, et leur étrangeté augmente le poids des infortunes ; point de mortel chez qui la surprise même n’ajoute à l’affliction.
Aussi n’est-il rien qu’on ne doive prévoir, rien où d’avance on ne doive se placer en esprit ; il faut prévoir non-seulement l’habituel, mais tout le possible. Car qu’y a-t-il que la Fortune ne précipite, dès qu’il lui plaît, de l’état le plus florissant, et qu’elle n’attaque et ne brise d’autant mieux qu’il se pare d’un plus bel éclat ? Qu’y a-t-il pour elle d’inaccessible ou de difficile ? Ce n’est pas toujours par une seule voie ni avec toutes ses forces qu’elle se rue sur nous. Tantôt armant nos mains contre nous-mêmes, tantôt contente de son seul pouvoir, elle fait naître le péril où l’écueil n’était point. Elle n’excepte aucun temps : de la volupté même elle fait éclore la douleur. La guerre surgit du milieu de la paix ; et les secours qui rassuraient se transforment en objets d’alarmes, l’ami en adversaire, l’allié en ennemi. De soudaines tempêtes, plus terribles que celles des hivers, éclatent par le calme d’un beau jour d’été. Sans ennemi, que d’hostilités on essuie ! Ce qui crée le désastre, à défaut d’autres causes, c’est l’excès de prospérité. La maladie atteint le plus tempérant ; la phtisie, le plus robuste ; la condamnation, le plus innocent ; les troubles du monde, le plus solitaire des hommes. Toujours le sort, comme craignant notre oubli, trouve un nouveau moyen de nous faire sentir sa puissance.
Tout ce qu’une longue suite de travaux constants, aidés de la constante faveur des dieux, réussit à élever, un seul jour le brise et le disperse. C’est donner un terme trop long à ces révolutions rapides que de parler d’un jour : une heure, un moment a suffi au renversement des empires. Ce serait une sorte de consolation pour notre fragilité comme pour celle des choses qui nous touchent, si tout était aussi lent à périr qu’à croître ; mais le progrès veut du temps pour se développer : la chute vient au pas de course.
Rien chez l’homme privé, rien dans l’État n’est stable ; hommes et villes ont leur jour fatal qui s’approche. Sous le plus grand calme couve la terreur ; et quand rien au dehors n’est gros de tempêtes, elles s’élancent d’où on les attend le moins. Des royaumes que les guerres civiles, que les guerres étrangères avaient laissés debout, s’écroulent sans que nulle main les pousse. Est-il beaucoup d’États qui se soient toujours maintenus prospères ? Donc il faut s’attendre à toutes choses et affermir son âme contre les chocs qu’elle pourra subir. Exils, tortures, guerres, maladies, naufrages, pensons à tout cela. Le sort peut ravir le citoyen à la patrie, ou la patrie au citoyen ; il peut le jeter sur une plage déserte ; ces lieux mêmes où s’étouffe la foule peuvent se changer en un désert. Mettons sous nos yeux toutes les chances de l’humaine condition : pressentons par la pensée, je ne dis point les événements ordinaires, mais tous ceux qui sont possibles, si nous voulons n’être pas accablés et ne jamais voir dans la rareté du fait une nouveauté qui stupéfie.
Source : Sénèque le Jeune - Lettres à Lucilius, lettre XCI